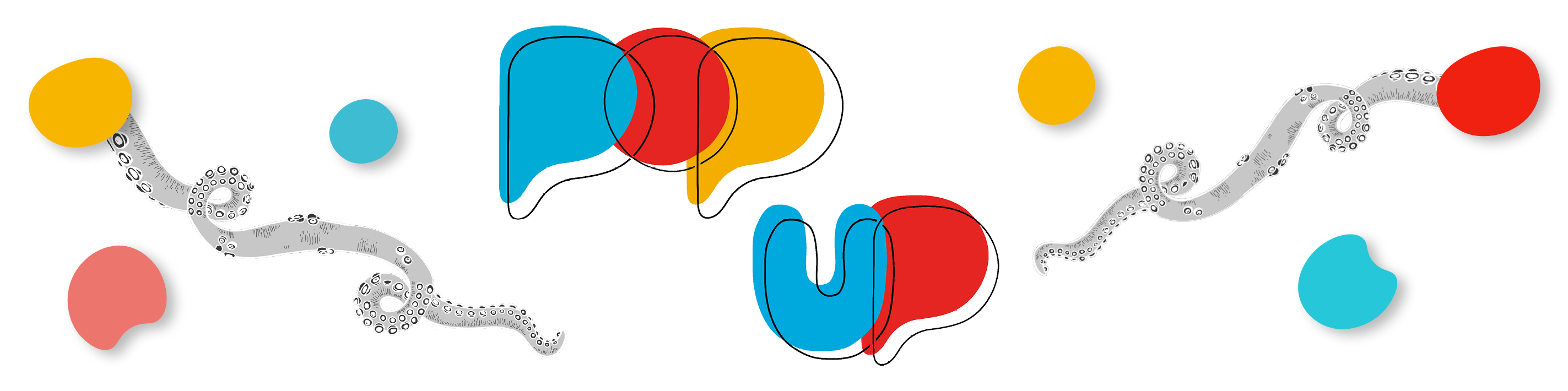Au Canada, plus de 1,6 million de personnes s’identifient en 2016 en tant qu’autochtones. Il existe plus de 634 Premières Nations – peuples autochtones canadiens distincts des Inuits et des Métis – qui utilisent plus de 50 langues distinctes ; au Québec seulement, il existe 11 nations autochtones, dont on dénombre environ 55 communautés différentes qui comptent plus de 100.000 membres à elles réunies.
Briser le silence
Il est des voix que l’on entend, des voix qui traversent aisément les âges et les mers pour parvenir jusqu’à nous. Il est des phrases que l’on nous a répétés si souvent qu’elles sont gravées en nous comme des évidences, comme des vérités immuables. « Jacques Cartier a découvert le Canada en 1534 » en est une qui a marqué au fer rouge l’éducation de nombreux canadiens, et en particulier des québécois.
Mais il est des voix que l’on n’entend pas ; des voix qui résonnent infiniment dans le silence assourdissant de l’ignorance, des voix dont on étouffe les cris à coups de mépris et d’indifférence, pour couvrir l’existence d’une réalité qui dérange. Au Canada, les peuples autochtones ont été réduits au silence pendant des siècles par une succession de législations déshumanisantes, afin d’assoir la dominance des populations européennes colonisatrices.
Un soldat canadien face à un protestant durant la crise d’Oka, 1er septembre 1990
L’histoire du Canada telle qu’enseignée pendant des dizaines et des dizaines d’années, c’est-à-dire profondément déformée et biaisée par le récit colonialiste, a transmis de nombreux stéréotypes au fil des générations et a entraîné une véritable invisibilisation des populations autochtones.
« J’avais 11 ans. […] Nous étions en 90. La crise d’Oka* éclatait et je comprenais pour la première fois que les Indiens existaient encore. » raconte Olivier Higgins dans son documentaire Québékoisie, co-réalisé avec Mélanie Carrier.
*Évènement politique opposant les Mohawks au gouvernement québécois en 1990 lors de révoltes, suite au projet d’extension d’un terrain de golf sur des terres sacrées pour les Mohawks.
Jacques Cartier n’a, par exemple, jamais « découvert » le Canada : comme l’affirme l’Atlas des peuples Autochtones du Canada de Canadian Geographic, « [les] colons ont trouvé, à leur arrivée, des civilisations autochtones pour la plupart fortes et prospères », disposant de systèmes culturels, économiques et langagiers développés.
« L’histoire de l’Amérique, c’est des mythes bien sûr, mais des mensonges scandaleux. »
– Serge Bouchard, anthropologue (extrait de Québékoisie)
Tuer la mémoire
« Où est-ce qu’on s’est séparés ? Où est-ce qu’on a tué la mémoire ? » interroge Serge Bouchard, anthropologue et spécialiste des Autochtones d’Amérique, dans le documentaire Québékoisie.
La Proclamation Royale de 1763
Le territoire canadien, appartenant historiquement à la Couronne britannique, a vu se succéder de nombreux traités concernant la situation des autochtones, et notamment concernant leur terres. En 1763 est créée la Proclamation royale, qui donne naissance aux systèmes de traités sur la propriété foncière et qui définit les fondements de la Constitution canadienne. Ces traités ont ainsi permis aux forces coloniales de faire main basse sur les territoires occupés par les nations autochtones : promettant des accords équitables, voire même avantageux aux « Indiens »* et jouant sur l’ambiguïté de leur compréhension des textes, ces traités ont adopté le statut d’accords « affirmant qu’aux termes de ceux-ci, les Autochtones ont « cédé et abandonné » tous les droits et titres qu’ils détenaient sur leurs terres ancestrales », comme l’explique l’Encyclopédie Canadienne.
*Ce terme désigne légalement le statut des Autochtones en tant que tels afin de marquer leur différence avec les Non-Autochtones ; on lui préfère aujourd’hui le terme « autochtone » ou « membre des Premières Nations » dans le langage courant, en raison de sa connotation péjorative.
Les traitements ambigus réservés aux Autochtones se sont multipliés et dégradés pendant plus d’un siècle, pour finalement mener à l’une des lois les plus discriminatoires de l’histoire du Canada : « l’Indian Act », ou la Loi sur les Indiens. Cette loi, apparue en 1876 pour regrouper plusieurs écrits antérieurs, a permis au gouvernement fédéral de prendre le contrôle des Premières Nations et du statut des Autochtones. L’objectif de cette loi était, à terme, d’annihiler le statut d’ « Indien » en instaurant une politique d’assimilation pour ne plus disposer que d’une société euro-canadienne et d’une culture uniforme. Rédigée suivant des principes racistes, elle définit les critères d’appartenance à telle ou telle « race » selon la descendance de l’individu et son affiliation à une « tribu » ; elle utilise le statut d’ « Indien » comme un statut provisoire permettant de passer de celui de membre des Premières Nations à celui de Canadien, une fois les normes et coutumes européennes adoptées. Ces mesures sont encouragées par l’Église : d’après Serge Bouchard, « c’est le clergé qui va interdire le récit métis ». Celui-ci aurait conforté le mythe de la « francité », celui d’un peuple canadien francophone qui viendrait exclusivement d’Europe et qui n’aurait jamais connu de métissage avec la population autochtone.
 Véritable autorité paternaliste, la Loi sur les Indiens a petit à petit retiré aux Autochtones une grande partie de leurs libertés, leur assignant un statut réducteur similaire à celui d’un mineur. Les parquant dans des réserves, elle a également conduit à la mise en place de pensionnats, écoles religieuses dans lesquelles les enfants autochtones, placés de force et arrachés à leurs familles, sont psychologiquement et culturellement « remodelés ». L’objectif de ces écoles est de « tuer l’indien dans l’enfant » : il est interdit pour celui-ci d’employer sa langue maternelle, au profit du français, et d’exprimer sa culture de quelconque manière pour en faire un parfait petit euro-canadien ; on estime qu’environ 150.000 enfants autochtones seraient passés par ces pensionnats, selon l’Encyclopédie Canadienne.
Véritable autorité paternaliste, la Loi sur les Indiens a petit à petit retiré aux Autochtones une grande partie de leurs libertés, leur assignant un statut réducteur similaire à celui d’un mineur. Les parquant dans des réserves, elle a également conduit à la mise en place de pensionnats, écoles religieuses dans lesquelles les enfants autochtones, placés de force et arrachés à leurs familles, sont psychologiquement et culturellement « remodelés ». L’objectif de ces écoles est de « tuer l’indien dans l’enfant » : il est interdit pour celui-ci d’employer sa langue maternelle, au profit du français, et d’exprimer sa culture de quelconque manière pour en faire un parfait petit euro-canadien ; on estime qu’environ 150.000 enfants autochtones seraient passés par ces pensionnats, selon l’Encyclopédie Canadienne.
« Je ne comprenais rien, mais après un mois, j’ai parlé français. Quelques années après que je suis sortie de là, c’est là que j’ai réalisé tout ce que j’avais perdu. Le fait d’être déracinée, je vais en vouloir toute ma vie, je crois. Tous les gestes que je vais faire, c’est en fonction de sauver ce qu’il reste. »
– Témoignage d’une membre de la nation Innue ayant connu les pensionnats (extrait de Québékoisie)
Bouleverser le système
Bien que la situation se soit considérablement améliorée, le passé difficile de la population autochtone a provoqué un véritable traumatisme générationnel dont les conséquences se font toujours ressentir : on observe notamment une perte continue de la langue, de la culture et des traditions, mais également des taux de suicide élevés – sur la période de 2011 à 2016, « le taux de suicide chez les Premières Nations était trois fois plus élevé que celui de la population non autochtone » et « chez les Premières Nations vivant dans une réserve*, le taux de suicide était environ deux fois plus haut que celui des Premières Nations vivant hors réserve », d’après le site Statistique Canada.
*Le terme « réserve » est encore employé aujourd’hui, il désigne des territoires définis et au statut spécial où sont établies des communautés autochtones, dont les membres sont libres d’entrer et de sortir.
En raison de ces lourdes séquelles et du décalage encore présent entre Autochtones et Non-Autochtones, nombreux sont ceux qui pointent du doigt la notion de racisme systémique, qui serait profondément ancrée au cœur de la société canadienne. Cette remise en cause du système par la population n’est pas nouvelle, mais elle connaît depuis quelques mois un retentissement particulier : l’émergence des mouvements de protestation anti-racistes à l’international, tels que le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis suite à la mort de George Floyd, un homme noir tué en mai dernier par plusieurs policiers accusés de racisme, a permis aux voix des minorités canadiennes et québécoises de s’élever et d’occuper une certaine place dans le débat national, voire international.
 Mais c’est un autre événement tragique qui a récemment rappelé la question du racisme institutionnel sur le devant de la scène médiatique : le décès de Joyce Echaquan, une femme de 37 ans appartenant à la communauté atikamekw de Manawan, au Québec, le 28 septembre dernier. Prise en charge pour des maux de ventre à l’hôpital de Joliette, près de Montréal, elle a filmé ses derniers instants et les a publiés en live sur Facebook, où l’on entend des membres du personnel hospitalier tenir des propos racistes et dégradants pendant que celle-ci hurle de douleur. « Joyce avait des problèmes cardiaques. […] Elle disait qu’on lui avait donné beaucoup de morphine » déclare une cousine de la victime dans un article de Radio-Canada. Cette affaire, vivement relayée sur les réseaux sociaux, a suscité une véritable indignation de la part de milliers d’internautes de part et d’autre de l’Atlantique ; les sphères politiques québécoises et canadiennes n’ont pas tardé à réagir, le premier ministre canadien Justin Trudeau évoquant une manifestation de « la pire forme de racisme », d’après l’AFP.
Mais c’est un autre événement tragique qui a récemment rappelé la question du racisme institutionnel sur le devant de la scène médiatique : le décès de Joyce Echaquan, une femme de 37 ans appartenant à la communauté atikamekw de Manawan, au Québec, le 28 septembre dernier. Prise en charge pour des maux de ventre à l’hôpital de Joliette, près de Montréal, elle a filmé ses derniers instants et les a publiés en live sur Facebook, où l’on entend des membres du personnel hospitalier tenir des propos racistes et dégradants pendant que celle-ci hurle de douleur. « Joyce avait des problèmes cardiaques. […] Elle disait qu’on lui avait donné beaucoup de morphine » déclare une cousine de la victime dans un article de Radio-Canada. Cette affaire, vivement relayée sur les réseaux sociaux, a suscité une véritable indignation de la part de milliers d’internautes de part et d’autre de l’Atlantique ; les sphères politiques québécoises et canadiennes n’ont pas tardé à réagir, le premier ministre canadien Justin Trudeau évoquant une manifestation de « la pire forme de racisme », d’après l’AFP.
Les violences hospitalières envers les individus autochtones ne sont pas rares au Canada : de nombreux témoignages sont diffusés depuis plusieurs années, notamment sur les réseaux sociaux. « On devrait se sentir en sécurité quand on va dans un hôpital, sentir qu’on est égal à quelqu’un d’autre », proteste Uliipika Kiguktak, une étudiante Inuk du Nunavut qui a elle-même subi des expériences traumatisantes suite aux traitements racistes de plusieurs médecins, selon l’AFP. L’agence de presse française évoque également l’existence d’un rapport de la commission d’enquête publique Viens, daté de septembre 2019, qui conclut que « les membres des Premières Nations et les Inuits du Québec sont bel et bien victimes de discrimination systémique dans leurs relations avec les services publics ».
Pour contrer cette problématique majeure, des initiatives sont envisagées par les communautés autochtones depuis plus d’une dizaine d’années, mais elles peinent à obtenir des financements suffisants. Radio-Canada rappelle, le 30 octobre dernier, « l’urgence de financer des centres de santé autochtones urbains au Québec » : il n’existe aujourd’hui que trois cliniques de santé autochtones dans la vaste province du Québec, la dernière en date ayant ouvert ses portes il y a un peu plus d’une semaine. Ces cliniques, dont l’objectif est d’assurer une prise en charge respectueuse et efficace des patients autochtones, luttent pour obtenir l’aide du gouvernement : la clinique Minowé, incorporée au « centre d’amitié autochtone » de la ville de Val-d’Or depuis plus de 10 ans, n’a jamais été officiellement reconnue comme une « offre de services publics », explique l’article de Radio-Canada. Afin de pallier le manque de représentation des individus autochtones dans le corps médical, quatre universités québécoises exercent actuellement un programme universitaire en partenariat avec les services sanitaires et sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, dont l’objectif est de former plusieurs dizaines d’étudiants autochtones à l’exercice de la médecine.
« Ça fait des générations et des générations que ça se passe dans le silence. […] Il faut dénoncer le racisme qu’on voit, il faut arrêter de ne pas le dire à haute voix. »
– Odile Joanette, directrice du studio de créations audiovisuelles Wapikoni mobile (d’après l’AFP)
Réconcilier les populations
Le terme de « réconciliation » est utilisé au Canada pour évoquer le projet de paix et d’amitié entre Autochtones et Non-Autochtones, mais aussi pour désigner les mesures prévues ou mises en place afin de réparer le fossé creusé depuis des siècles entre les différentes populations : il a notamment donné cours aux excuses nationales du Canada, présentées par l’ex-premier ministre Stephen Harper en 2008. Promesse phare du premier ministre Justin Trudeau lors de son élection en 2015, le processus est pourtant largement critiqué, beaucoup estimant que le gouvernement n’en fait pas assez pour la résolution des problématiques autochtones.
Le premier ministre canadien Justin Trudeau avec le chef national de l’Assemblée des Premières nations Perry Bellegarde
Alors que de nombreuses discussions entre représentants canadiens et chefs autochtones ont eu lieu au cours des dernières années, la discordance entre paroles et réalité est pour le moins frappante. Certaines questions de société majeures, telles que les taux de violences subies par les femmes et filles autochtones, semblent ne pas connaître de progrès : en effet, les désaccords présents depuis plus de cinq ans entre les chiffres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et ceux des groupes de femmes autochtones sont toujours d’actualité – l’une reconnaît environ 1200 cas de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées entre 1980 et 2012 quand l’autre estime plutôt ce nombre proche de 4000, d’après l’Encyclopédie Canadienne. Toutefois, l’organisme Statistique Canada détermine un « taux d’homicide près de sept fois plus élevé pour les femmes autochtones que pour les femmes non autochtones » entre 1997 et 2000. Face à ces réalités déplorables, le gouvernement lance certaines initiatives telles que le financement de commémorations pour les femmes disparues et assassinées, avec notamment la mise à disposition d’un fonds fédéral de 13 millions de dollars pour plus de 100 commémorations à travers le pays, rapporte le site de RCI.
Cependant, les mesures concrètes telles que des restructurations d’institutions fédérales, demandées par plusieurs experts et expertes autochtones, ne sont pas au rendez-vous. « Cette restructuration implique que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux doivent renoncer à certaines de leurs compétences, ce qui nécessitera une transformation réelle de la structure existante », explique Gina Starblanket, professeure adjointe en sciences politiques à l’Université de Calgary dans un article de RCI. En réalité, plusieurs institutions s’attirent les foudres de la population : la police canadienne, notamment, est visée par de nombreuses accusations de violences envers les minorités, à l’instar de sa voisine américaine. Comme aux États-Unis, plusieurs affaires d’individus décédés dans des circonstances troubles suite à l’intervention de policiers ébranlent la confiance de la population : Radio-Canada évoque par exemple la mort de Chantel Moore, une jeune femme de 26 ans issue de la nation Tla-o-qui-aht, chez qui la police a été appelée en juin dernier en raison de publications inquiétantes sur les réseaux sociaux. À leur arrivée, celle-ci était paniquée et tenait un couteau : les policiers l’auraient alors immédiatement abattue de plusieurs balles, sans pour autant que l’on sache si celle-ci les avait menacée.
Entre hier et aujourd’hui, il est évident que les nations autochtones ont parcouru un long et périlleux chemin. Mais bien que leurs voix résonnent bien plus fort qu’avant, les violences, les injustices, les abus de pouvoir et l’accaparation des territoires, notamment avec les chantiers énergétiques qui défrichent les forêts et détruisent les sols, existent toujours. Long est le chemin pour venir à bout de l’inégalité et des dégâts historiques du colonialisme, mais un jour peut-être leurs voix arriveront-elles à couvrir celles du racisme et du mépris.
Romane Pelletier
Crédits photos : Andre Forget – Agence QMI / The Canadian Press / Bibliothèque et Archives Canada / Archives Canada / Capture d’écran de la vidéo Facebook de Joyce Echaquan, extraite du site de Radio-Canada / Sean Kilpatrick – La Presse Canadienne