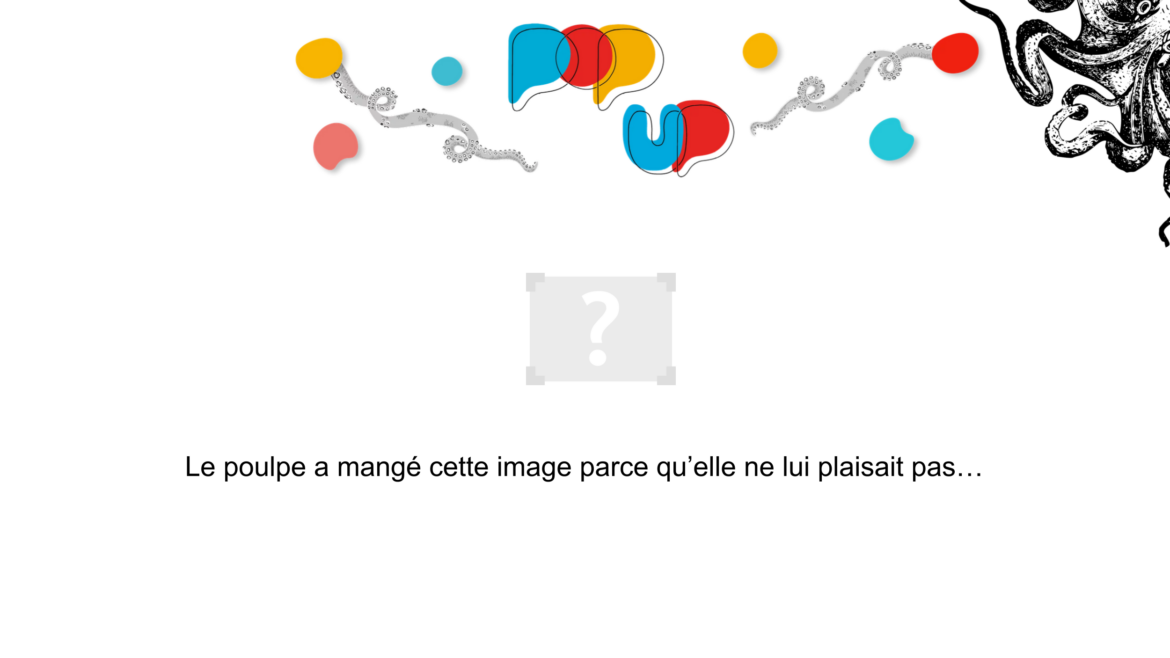Là-haut, la Terre est vaste, ronde, unie, totale et bleue. Mais teintée du blanc cendré de ses forêts californiennes, corses et australiennes qui flambent.
Voici le récit testimonial de l’enfant qui voit sa mère mourir sous ses yeux.
Orbitant à plus de 300 km d’altitude, Thomas Pesquet regarde une planète dont les traits s’affaissent à vue d’œil depuis sa dernière sortie dans l’espace de novembre 2016 à juin 2017. Lors d’un entretien avec le président de la République Emmanuel Macron, début novembre 2021, l’astronaute témoignait d’une accélération évidente des sinistres météorologiques sur Terre : « Par le hublot de la Station spatiale, on voit distinctement la fragilité de la Terre, une oasis avec des ressources limitées, et les effets néfastes des activités humaines, la pollution des rivières, la pollution atmosphérique ».
Coupé des éléments géopolitiques, le hublot de l’ISS ne laissant transparaître que l’image d’une planète où l’Homme n’apparaît pas, on pourrait croire que la Terre brûle et que c’est de son propre fait.
Mais Thomas Pesquet nous rappelle très justement que l’action humaine est effectivement le catalyseur, si ce n’est la cause, de ces phénomènes climatiques désastreux.
Alors, à défaut de figurer un visage anthropisé, la Terre s’anime d’un esprit personnifié : elle est « fragile », elle pense, elle souffre et elle réagit.
L’identité de la planète se décline donc en deux natures différentes suivant l’altitude depuis laquelle elle est regardée. Depuis l’écorce terrestre, elle est la Terre ; depuis l’espace, elle est Gaïa, la mère nature, l’esprit transcendant forêts et déserts de la banquise sibérienne aux lacs de la Terre de feu.
Et ces deux perspectives se rejoignent dans notre écologie politique : la planète brûle en raison de l’anthropisation débridée et elle se venge ! Elle se révolte ! Elle se rebiffe contre les voyants électriques laissés trop longtemps allumés dans la nuit !
À raison, les scientifiques sont intraitables à ce sujet, mais c’est en négligeant le fait que d’autres logiques puissent encore nous échapper (l’alternance des cycles de réchauffement et de refroidissement qui précèdent l’arrivée des Hommes par exemple) et en cultivant l’idée d’un éternel combat nature vs culture.
L’analogie que fait Francis Duranthon, paléontologue émérite, conservateur en chef et directeur du Museum de Toulouse, dans un article de 20minutes d’octobre 2019, entre un vol d’avion et l’histoire de l’Homme sur Terre est intéressante à ce titre.
Francis Duranthon nous dit qu’un « avion a des ailes qui sont rattachées au fuselage par des rivets. Tous les rivets sont des éléments de la biodiversité, si on en enlève un, ce n’est pas trop grave, mais au bout d’un certain nombre d’éléments de biodiversité qu’on enlève, l’aile se détache et comme nous sommes dans la carlingue, nous nous crashons avec le reste du système ».
Petite mise en (rétro)perspective de cette citation : l’ère historique préindustrielle témoigne de l’une des éruptions volcaniques les plus puissantes de ces 10 000 dernières années. Entre 1257 et 1258, un phénomène éruptif d’une rare brutalité plonge les XIIIe et XIVe siècles dans une période de refroidissement climatique qui porte aujourd’hui le nom de « Petit Âge glaciaire ». Bien qu’à l’origine de nombreuses famines et autres catastrophes de cet ordre, la nature ne nous indemnisera pas pour les dommages du passé.
Cette perspective permet une nouvelle lecture de Francis Duranthon : on y comprend qu’en raison même de l’imperfection de la nature et de son essence arbitraire, l’espèce humaine ne vit que pour elle-même – elle est seule dans la carlingue – et qu’elle se considère comme tributaire du maintien de la biodiversité.
Puisqu’il s’agit certainement de la fin la mieux partagée par l’ensemble du vivant (la préservation de l’espèce avant tout), peut-être que c’est par la réciprocité d’un sentiment de dépendance entre les espèces vivantes que l’écosystème planétaire parvient à s’équilibrer. Il serait donc orgueilleux que de penser la dette de la Terre à notre égard, ou la nôtre au sien. À vrai dire, elle se portait normalement sans nous et finira par se rétablir de notre inévitable disparition.
La question d’un clash nature contre culture est donc a priori discutable.
Le péril climatique : procès des Hommes
En revanche, le dévoiement du « sentiment de réciprocité », sûrement imputable à l’avènement de la pensée cartésienne en Europe, soit le moment où l’Homme s’est rendu « maître et possesseur de la nature » (Sixième partie du Discours de la méthode – Descartes, 1637), rompt l’équilibre. Les abeilles disparaissent, nous basculons dans un extrême, c’est excessif, c’est problématique.
Mais les solutions que nous cherchons se trouvent depuis les questions que nous posons. Et aujourd’hui, le constat est simple : la terre brûle. Alors, qui l’a mise sur le bûcher ? Et qu’a-t-on pu reprocher à la planète pour qu’elle subisse de la sorte ? De n’être justement pas unie ? Pas faite de la même pierre partout ? Auquel cas, elle brûle sur le bûcher mondialiste. Le bûcher qui s’alimente en bois transylvanien, qui s’allume avec un BIC français, lui-même carburant au gaz russe, pour que les industriels du charbon allemands puissent finalement en récupérer le carbone résiduel.
Et donc brûle-t-elle par conséquent sur le bûcher de l’histoire des Nords (cf. la pensée cartésienne). On a pu entendre durant la COP26 de la part du ministre de l’environnement indien, Bhupender Yadav, que les pays en développement « ont droit à un usage responsable des énergies fossiles ». Il s’agirait donc pour eux d’atteindre un stade de développement équivalent à ceux des Nords dans les plus brefs délais, quitte à dégrader le climat, plutôt que de chercher à établir un moyen de développement, durable pour tous, du Nord au Sud.
Cet argument s’inscrit dans la rhétorique qui voudrait que les pays du Sud, en raison de la domination qui a été celle des pays du Nord depuis le XIXe siècle, évidemment permise par un usage technologique des ressources fossiles, auraient droit à leur part de pollution.
Quant à l’écologie politique, partant d’un constat similaire – celui du renversement de l’équilibre, conséquence de l’Histoire des Nords – elle prend régulièrement la forme d’une sorte de repentance de l’Homme vis-à-vis de la nature.
Pour ne prendre que cet exemple, la transition vers le transport tout électrique et l’énergie éolienne suppose une présence néocoloniale dans les pays africains – dont la RDC, où l’exploitation du cobalt pose un réel problème humanitaire – à même de produire les métaux rares capables d’alimenter les moteurs électriques. Cela pose la question du choix entre le crime contre la nature et le crime contre l’humanité, sinon celui du bête et méchant moindre mal. Et l’écologie politique peine à se positionner sur ce sujet.
Peut-être parce que la Terre est plus sacrée que l’humanité ? Une vision qui donne à penser que nous sommes coupables, que la Terre est victime et que notre repentance se fera au détriment de nos droits d’Hommes en principe inaliénables.
Et qui implique l’idée que l’Homme est capable de faire le pari du vivant avant de faire le pari de l’humanité.
Or si, comme l’ont bien montré Thomas Pesquet et Françis Duranthon, ces deux enjeux sont corrélés, il convient néanmoins de donner la priorité au second, car notre survie est la fin en soi.
Quoi qu’il en soit, la question écolo-éthique du capitalisme subsiste, qu’il soit thermo-industriel ou vert, et mérite de sévères remises en question. Car les deux voies énoncées ici envisagent soit de littéralement persévérer dans la destruction de l’environnement, soit de dédommager la planète en dépit de vies humaines.
Et l’optimisme dans tout ça ?
L’exemple des voitures électriques reste pertinent.
Car renvoyant à des problématiques néocoloniales et écologiques concernant l’extraction et la transformation très polluante des métaux rares (cobalt, lithium, etc.), donnant lieu à une surexploitation des populations locales, le « VE » (véhicule électrique) laisse tout de même entrevoir une lueur d’espoir (sur le plan écologique seulement).
Un rapport de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) datant de 2016 atteste certes que « le VE [véhicule électrique] a des impacts négatifs sur l’environnement, majoritairement durant sa phase de fabrication, notamment sur l’acidification des milieux et le potentiel d’eutrophisation de l’eau. Sur le cycle de vie du véhicule, ces impacts sont toutefois du même ordre de grandeur pour un VE que pour un véhicule thermique (pour l’acidification des milieux, l’impact du VE est supérieur de 25 % à celui d’un véhicule diesel ; pour le potentiel d’eutrophisation, l’impact du VE est inférieur de 45 % à celui d’un véhicule diesel) ».
Mais l’innovation technologique dans ce domaine présente une perspective d’avenir brillante en termes écologiques comme le précise le même rapport : « L’utilisation en seconde vie et le recyclage des batteries permettent de diminuer ces impacts environnementaux ».
Cette perspective est déjà en elle-même une troisième voie vers une écologie plus rationnelle, au-delà du dédommagement pour l’Histoire ou pour la mère nature.
Surtout depuis 2011, date à partir de laquelle elle acquiert une existence politique et pratique lorsque l’Union européenne impose aux constructeurs automobiles le recyclage d’au moins 50 % des batteries.
Ainsi, nous pouvons interpréter Thomas Pesquet, Francis Duranthon et Bhupender Yadav de cette manière : la Terre ne doit pas être perçue comme « victime » de l’humanité ; nous appartenons à un écosystème imparfait ; la véritable écologie est anthropocentrée ; il n’y a de clash entre la nature et la culture que depuis que l’Homme s’est rendu maître de la nature.
En y ajoutant les travers de l’écologie politique, dont fait partie le tout électrique renouvelable et ses implications éthiques, nous pouvons penser que basculer de l’extrême du capitalisme thermo-industriel à celui d’une forme de repentance et de sacralisation de la planète n’est peut-être pas la solution.
À ce propos, Jean-Marc Jancovici (créateur du bilan carbone et fondateur du Shift Project) dit : nos sociétés capitalistes sont fondées sur l’exploitation de ressources fossiles limitées et en ce sens, elles sont vouées à la décroissance, car plus le PIB mondial augmente, plus les ressources diminuent.
Et à cela, Hubert Reeves (président d’honneur d’Humanité et biodiversité) ajoute : « La nature n’a pas de poubelles, car elle ne produit pas de déchet ».
Alors, que les dinosaures reposent en paix 5 kilomètres sous terre et place au recyclage.
Bonjour, je m’appelle Clément Pasquet-Etchebarne, j’étudie en Master d’Histoire, Géopolitique et Relations internationales. Je suis passionné d’Histoire, de philosophie et de sports de combat. J’aime croiser ces disciplines entre elles, je crois que ça m’aide à voir le monde sous un angle intellectuel et sensible.